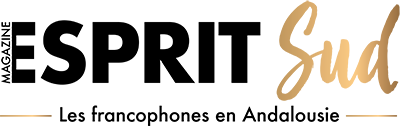Clap de fin sur le Festival du Film Français de Málaga avec la proclamation d’un palmarès qui couronne principalement le film de Marie-Hélène Roux, « Muranga, celui qui soigne » avec le prix du jury professionnel, celui du public et de l’interprétation pour Isaach De Bankolé (ex-aequo avec Juliette Armanet pour son rôle dans « Partir un jour »). « Furcy, né libre » dirigé par Abd Al Malik décroche quant à lui le prix du jury junior. Cerise sur le gâteau, s’en est suivie la projection du second long-métrage de Vincent Maël Cardona, « Le Roi Soleil » qui a régalé les spectateurs venus nombreux en cette ultime soirée dédiée au 7ème art. Un film singulier, audacieux, parfois déroutant, a donc clos cette 31e édition et c’est avec un immense plaisir que nous avons pu échangé avec le réalisateur breton, révélé avec « Les Magnétiques » (César du meilleur premier film en 2022). A travers cette ultime pépite, le réalisateur passionné s’impose une nouvelle fois comme une voix à part dans le cinéma français, mêlant réflexion sur la société, mise en abyme du réel et regard profond sur notre besoin de fiction.
Tout débute dans un des plus communs, un bar-tabac à Versailles. Ce lieu banal, presque anodin, s’appelle « Le Roi Soleil ». « Le nom du film vient avant tout du nom du bar », explique Vincent Maël Cardona. « C’est crédible à Versailles, logique même. Mais c’est aussi une manière de questionner cette expression, « le Roi Soleil », qui est devenue une sorte de fiction collective. Pendant des siècles, elle a permis à organiser notre société. Aujourd’hui, elle est démonétisée, au point qu’on peut l’utiliser pour nommer un bar ». Une question peut alors se poser, quelle fiction tient encore notre monde ?
Cette idée de la fiction comme pilier de nos vies traverse tout le long-métrage. Derrière l’apparente légèreté d’une histoire de loterie, le réalisateur explore nos illusions, nos désirs et notre rapport au réel. « Ce n’est pas tant la loterie en elle-même qui m’intéressait, confie-t-il, mais ce qu’elle symbolise. C’est une métaphore de notre société de consommation, une société de l’avoir au détriment de l’être. On rêve d’une autre vie, d’un coup de chance, d’un miracle… C’est humain, mais c’est aussi vertigineux». La chute est en effet des plus rudes pour ces personnages attrapés par cette quête insensée de toucher à ce rêve d’une autre vie facilitée par un gain mirobolant.
Le film s’ouvre sur un prologue inattendu, un détour historique, sur la naissance de la loterie en France fin du XVIIIe siècle. « On revient sur l’instauration de la loterie sous Louis XV pour financer l’école militaire ». L’idée vient d’un marchand vénitien conseillé par Casanova. C’est historique, et c’est fou. Casanova, la séduction, le hasard, l’argent, tout est déjà là. Et pour moi, c’était une façon de dire que ce choix de société, celui du hasard et du gain, a façonné le monde dans lequel on vit. D’autres chemins étaient pourtant possibles… ». Les dialogues de cette scène initiale nous offre un miroir « historique » à ce que nous vivons aujourd’hui avec cette course effrénée à l’argent et au paraître. Cette ouverture, déroutante, pose le ton car « Le Roi Soleil » ne cherche pas à rassurer, bien au contraire.
Le film se construit ensuite comme un piège narratif où les personnages, enfermés dans un huis clos, inventent tour à tour différentes versions d’une même réalité. « Ce film explore aussi notre addiction à la fiction, notre propension à nous raconter des histoires. Je crois qu’il fallait que la forme même du film convoque cette idée. C’est pour ça qu’il y a différents genres, différentes tonalités, un glissement permanent. On part du réalisme pour aller vers quelque chose de plus fictionnel, puis d’absurde, presque délirant. Les personnages, comme le film lui-même, s’éloignent progressivement du réel».
Le film est exigeant, parfois déstabilisant mais son réalisateur assume pleinement cette complexité. « Il y a quelque chose de presque expérimental dans la narration. On demande au spectateur une certaine souplesse, une attention. C’est un film qui se transforme, qui s’enfonce progressivement dans la fiction. À mesure que le piège se referme sur les personnages, la frontière entre le réel et l’imaginaire devient floue ». Le scénario est travaillé avec grande finesse, certaines scènes sont présentées plusieurs fois, avec le choix de points de vues différents. Certaines scènes intriguent et questionnent le spectateur pour ensuite faire place à d’autres qui font basculer ce dernier dans un véritable carnage. Une esthétique soignée et une poésie omniprésente complètent ce voyage cinématographique, nous évoquant parfois l’influence du cinéma coréen.
Le scénario, il l’a coécrit avec son ami Olivier Demangel, rencontré à la Fémis (École nationale supérieure des métiers de l’image et du son). « Nous étions camarades de promo, raconte-t-il. À la sortie de l’école, on s’était dit qu’un jour, on travaillerait ensemble. En 2010, on a commencé à écrire un film simple que l’on voulait peu coûteux, un huis clos avec quelques personnages dans un simple bar-tabac. Et puis, nous avions lu cette phrase qui nous avait beaucoup fait rire à l’époque, on a autant de chance de gagner au loto que de mourir d’une balle perdue. À partir de là, tout s’est enchaîné».
Le projet dort des années, avant d’être repris et transformé par nos deux compères. « On l’a relu dix ans plus tard. Le monde avait changé, nous aussi. Le film a pris dès lors une autre dimension».
Après « Les Magnétiques », César du meilleur premier film, Vincent Maël Cardona aurait pu choisir la facilité et faire un film plus commercial, plus “vendable”. Il a préféré emprunter un chemin de traverse et nous régale aujourd’hui avec un film percutant. « Le César m’a donné de la liberté. Je crois qu’il faut s’en servir pour repousser les limites, pour tenter des choses, résister au formatage. Le cinéma doit pour moi, rester un espace d’essai, de recherche. Ce n’est pas le chemin le plus simple, mais c’est celui qui me ressemble. Le grand paradoxe du cinéma est d’être tiraillé entre l’art et l’industrie. Moi, j’aime cette tension, cette conflictualité, extrêmement fertile et fondamentale ».
Installé aujourd’hui à Lyon, par amour, nous dit-il dans un éclat de rire, le réalisateur vit dans les pentes de la Croix-Rousse, où il écrit son prochain film. Ce projet encore en gestation est lié à la crise écologique. « C’est une grande thématique, très saturée, très sensible. J’essaie de trouver une manière de l’aborder à hauteur d’hommes, à l’échelle de quelques personnages. C’est encore abstrait, mais ça viendra. J’étudie aussi la possibilité d’y mêler des personnes venant de différents coins du monde, parlant des langues différentes».
Pour lui, le cinéma reste avant tout un espace de partage. « Ce qui me fascine, c’est le paradoxe de la salle, on s’y enferme, on s’éloigne du monde, on se met dans le noir, face à un mur et c’est là qu’on se retrouve le plus près du réel. C’est une expérience collective et intime à la fois. Et dans un monde saturé d’écrans et de numérique, je crois que le besoin de sortir, de voir quelque chose ensemble, de se frotter à l’autre, est plus important que jamais». Quand je lui demande s’il trouve le monde dangereux, il marque une pause. « Je ne dirais pas dangereux. Il est plutôt confus. Nous vivons dans un monde de perte de repères, de confusion des récits. On a de plus en plus de mal à se mettre d’accord sur une même réalité, à partager des faits. Tout devient mouvant, sujet à caution. Et ça attise les tensions. D’une certaine manière, « Le Roi Soleil » parle de cela, de ce combat entre un délire et le réel. Et la question finale, c’est qui va gagner… ».
Vincent Maël Cardona est de ceux qui préfèrent les zones grises aux certitudes. Dans son cinéma comme dans sa vie, il s’interroge, expérimente, observe. J’ai rencontré un cinéaste qui croit encore à la puissance du récit, mais surtout à sa capacité à nous révéler. « La fiction est nécessaire. C’est ce qui nous permet d’affronter le réel. Mais il faut rester conscient de ce qu’elle est, une construction, un miroir déformant».
À Málaga, le public a longuement applaudi Le Roi Soleil, film à la fois lucide et poétique, qui nous parle de nous, de nos rêves, de nos contradictions. « Ce que j’aime dans les festivals comme celui-ci, conclut-il, c’est la rencontre. Voir comment un film français résonne en Espagne, dans une autre langue, une autre culture. Le cinéma est une passerelle. L’imaginaire, c’est ce qu’on partage tous». Il dit aussi avoir été plongé dans un véritable rêve dès qu’il a posé les pieds à Málaga. Cette ville possède une énergie intense, je m’y sens tellement bien et je ressens déjà une énorme frustration de la quitter après seulement 24h00 ».
Málaga a conquis le cœur de Vincent Maël Cardona et quant au réalisateur, il nous a véritablement bluffé avec sa dernière pépite. Il réside dans ce film une force, une tension entre l’ombre et la lumière, entre l’illusion et la vérité, entre ce que nous voyons et ce que nous croyons voir. Comme un tirage au sort du destin où l’on ne sait jamais vraiment si l’on gagne ou si l’on perd. Si gagnant, il y a …